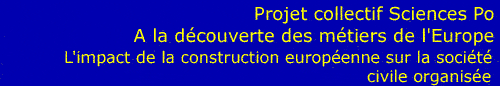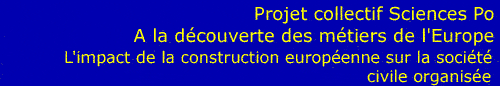|
Phase
de développement de la proposition : le rôle central
des acteurs de la société civile
L'élaboration des politiques
au niveau européen se fait dans une coopération étroite
entre les institutions et les acteurs de la société
civile. Ainsi, la Commission recueille, pour la rédaction
de sa proposition, les avis des différentes parties prenantes.
Il va de soi que ces acteurs sont assez hétérogènes,
vu la diversité des politiques. Ceci peut englober des entreprises
ou leurs associations (comme l'EFPIA
pour l'industrie pharmaceutique),
les partenaires sociaux ou les ONG qui rassemblent les acteurs spécialistes
en la matière et qui se trouvent sur place, à Bruxelles.
Les cabinets de lobbying spécialisés (comme
KEA consulting
pour le cinéma et la musique indépendante) sont aussi
des acteurs indispensables pour l'apport d'expertises.
Il y a également des acteurs faisant partie ou étant
proche des administrations des Etats membres, comme les représentations
des régions qui y sont concernées (comme la représentation
de l'Andalousie) ou des agences nationales, voire européennes
indépendantes (comme
l'EMEA).
Le projet
de loi par la Commission
La Commission a quatre tâches
: elle est législateur, elle participe à l'exécution,
elle est gardienne des traités et le porte-parole dans les
négociations. Ses décisions et propositions sont censées
refléter l'intérêt de l'ensemble des pays membre
de l'Union européenne. La Commission a le droit exclusif
d'initiative. Suite à des demandes de groupes d'intérêts,
elle peut faire une proposition de loi (règlement ou directive).
En outre, elle est en charge de renouveler ou modifier les directives
en vigueur pendant une durée limitée
(comme la directive " télévision sans frontière
"dans le cas de l'audiovisuel). C'est elle qui détermine
donc la politique communautaire et sa mise en œuvre.
Phase de consultation : les acteurs de la
société civile sont à nouveau sollicités
Etant donné qu'entre la proposition
et l'adoption de la légalisation définitive s'écoulent
au moins plusieurs mois, voire plusieurs années, les acteurs
de la société civile ont la possibilité d'influencer
la rédaction des textes législatifs. Ce sont les mêmes
acteurs que lors de la phase initiale. De plus, il y a selon les
matières des consultations obligatoires avec des différents
comités (en plus du comité
économique et social et du comité
des régions).
L'Acte de décision
Diverses
procédures de décision mènent à
l'adoption d'un règlement ou d'une directive, en fonction
de la politique concernée. La codécision est appliquée
le plus souvent aujourd'hui. Sur proposition de la Commission et
après avis du Parlement (et, le cas échéant,
du Comité économique et social et du Comité
des Régions), le Conseil adopte une position commune à
la majorité qualifiée.
Le Parlement Européen dispose de trois mois pour adopter
ou rejeter à la majorité absolue de ses membres cette
position commune.
Si nécessaire, un comité de conciliation élabore
un projet qui doit être adopté par le Parlement Européen
à la majorité absolue et par le Conseil à la
majorité qualifiée.
Mais d'autres procédures de
décision existent qui ne donnent pas le même statut
au Parlement, comme c'est le cas dans la politique extérieure
(ex. Balkans) ou encore dans l'exemple des
brevets européens
L'exécution
des politiques adoptées
Dans un dernier temps, les politiques
ainsi adoptées sont mises en œuvre par les différents
acteurs à des niveaux distincts selon les domaines.
Dans le cas de l'aide humanitaire, par exemple, l'office ECHO coordonne
l'aide humanitaire dans les pays concernés et coopère
avec les différentes
ONG sur place. Il convient de mentionner que l'UE elle-même
incite à former des réseaux d'activité. Elle
l'exige même parfois, comme dans le cas de la mise en œuvre
d'activités culturelles : ce n'est qu'à partir de
trois partenaires que des aides peuvent être demandées
auprès des institutions européennes.
A ce niveau, la Commission tend donc à encourager la décentralisation
dans la mesure où elle attribue la gestion des projets à
des unités plus petites et directement concernées
par les décisions. Dans le cas de la politique régionale
ceci se manifeste dans la gestion des programmes financés
par les Fonds structurels par des autorités régionales
et locales.
|