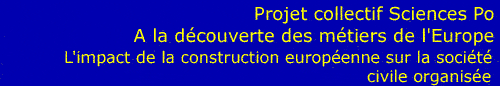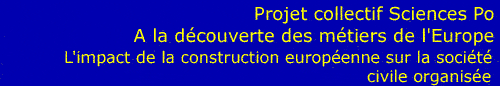|
La table ronde a porté sur
l’avenir de la politique régionale de l’UE et les
métiers liés à sa mise en œuvre. Dans
l’objectif de rendre compte à la fois des problématiques
actuelles de la deuxième politique communautaire et des acteurs
des différents niveaux ont participé :
Sylvain
Maréchal, Secrétaire administratif de l’Association
des Villes Historiques de l’Eurorégion
Pierre-Jérôme Hénin, porte-parole de Michel
Barnier, Commissaire à la politique régionale et à
la réforme des institutions
Andrzej Pawlica, directeur de la représentation
de Malopolska (Pologne) à Bruxelles
Nicolás Cuesta, responsable
de la politique de cohésion, représentation de l’Andalousie
(Espagne) à Bruxelles
Frank Demaille, Préfecture
région Ile-de-France, chargé de mission, responsable
des fonds européens
Claude Marcori, DATAR, chargée
du programme INTERREG, service des affaires européennes et
internationales
Le débat a été
animé par Sylvain Kahn,
directeur des affaires européennes à Sciences Po Paris
L’avenir de la politique régionale
communautaire
L'élargissement de l'UE à
25 et 27 membres constitue un défi majeur pour cette deuxième
politique communautaire (cf. notre étude de cas). Les intervenants
de la table ronde ont confirmé ce constat. Pourtant, le débat
lancé par Michel Barnier en 2001 sur l’avenir de la
politique régionale à partir de 2007 et qui s’achèvera
en 2003 s’est calmé depuis quelques mois, comme l’a
souligné P.-J. Hénin. En effet, pour la période
2004-2006, des fonds spéciaux ont été créés
à destination des nouveaux pays membres. Leur somme s’élève
à 22 milliards d’euros (dont la moitié pour la
Pologne) n'aura aucune incidence pour les pays membres. Aussi la
Commission maintiendra-t-elle son engagement de continuer à
maintenir un fort flux financier vers les régions pauvres:
Deux tiers des attributions vont à destination des régions
les plus pauvres (objectif 1), aux fonds de cohésion et au
phasing out et un tiers aux autres régions. Ainsi un large
consensus existe parmi les pays actuellement membres qu’une
forte politique de cohésion doit être maintenue pour
offrir aux nouveaux pays des possibilités similaires que
ceux dont ils ont pu profiter.
Néanmoins, de nombreuses questions restent ouvertes, comme
le pourcentage du PIB communautaire consacré à la
politique régionale : certains plaident pour les 0,45% existants,
tandis que d’autres acteurs dans l’administration centrale
en France font remarquer que cela continue à être un
taux problématique et que les propositions de Barnier constitueraient
un « menu à la carte ».
Le rôle des régions des nouveaux pays de l’UE
est une thématique qui mérite l’attention : certaines
des régions sont déjà présentes à
Bruxelles depuis quelques années et témoignent des
changements administratifs et structurels nécessaires à
l’adhésion. La Pologne par exemple, entrant dans l’Union
européenne en 2004, a complètement restructuré
l’organisation de ces collectivités territoriales. S’élevant
encore au nombre de 50 pendant l’époque communiste,
les régions polonaises ont été réduites
à 16 après 1989. Les compétences de ces régions
correspondent à peu près à celles des régions
françaises. Actuellement, il y a six régions polonaises
présentes à Bruxelles, d’autres suivront l’année
prochaine. Leurs bureaux, créés entre 1999 et 2003,
ne disposent que d’un effectif très réduit (1
à 2 personnes).
La région Malopolska entretient des coopérations avec
cinq autres régions de pays européen différents.
Son premier partenaire est la région Rhônes-Alpes qui
non seulement lui a mis à disposition un de ses bureau à
Bruxelles mais qui lui donne également un soutien technique.
Cette coopération entre une région des pays candidats
et une région d’un Etat membre est un bon exemple et
mérite d’être encouragée, d’autant
plus qu’il s’agit d’une coopération bilatérale
hors financement communautaire.
Au-delà de la problématique
de l’élargissement, il ne faut pas non plus oublier
les impacts des fonds structurels sur les régions de l’UE
15 : L’Association des Villes
Historiques de l’Eurorégion a pu réaliser
de nombreux projets grâce aux subventions européennes
provenant de l’initiative communautaire INTERREG III A, allant
de la création d’un site web et d’un numéro
de téléphone interactif trilingue à la promotion
du secteur touristique de ces régions. Etant donné
que les projets de cette association transfrontalière fonctionnent
le plus souvent à court terme et ont une durée déterminée,
la question des effets qu’aura l’élargissement
sur la politique régionale ne joue qu’un rôle
insignifiant pour elle.
Il en va de même pour la région de l’Andalousie
qui restera dans l’objectif 1 à partir de 2007. M. Cuesta
a souligné que la finalité de l’objectif 1 est
de toute manière d’en sortir et que ne pas en sortir
implique que des avancées considérables seront encore
à faire. Le but ultime de toute région éligible
à l’objectif 1 est de n’être plus dépendante
des fonds structurels un jour.
Un des objectifs dans l’avenir sera sans doute de renforcer
les stratégies et les priorités régionales
au niveau communautaire, notamment en matière d’innovation,
de compétitivité territoriale, de villes (URBAN) et
des régions de montagnes. Il faudrait en effet accroître
la visibilité sur les zones en difficultés à
l’intérieur des villes. La DATAR regrette que selon
la Commission les infrastructures ne devraient pas être prises
en compte. Une intervention en matière d’infrastructure
ferait œuvre utile et permettrait une visibilité très
forte face à la population.
Enfin, M. Hénin a insisté sur le fait que ce n’est
PAS la Commission qui décide du cadre financier de la politique
régionale mais les Etats membres. Le Conseil européen
adoptera le nouveau cadre début 2006.
Travailler pour l’Europe
Du débat est clairement surgi
que dans l’avenir, il sera de plus en plus difficile d’entrer
dans les institutions par la voie des concours : actuellement, seulement
des concours sont ouverts pour les candidats maîtrisant au
moins une des langues des nouveaux pays adhérents. Ainsi,
l’année prochaine, 3900 personnes seront recrutées.
Vu que les concours se font non en fonction de la nationalité
mais des langues, les perspectives pour les ressortissants de l’UE
15 qui ne maîtrisent pas une de ces langues se voient fortement
diminuées.
A partir de ce constat, quelles sont donc les possibilités
de travailler pour l’Europe ? Une possibilité consiste
à se faire envoyer en tant qu’expert national détaché
dans les institutions. Il a également été rappelé
que la Commission n’est pas la seule institution qui offre
des opportunités de carrière, mais qu’il y en
existe également au Parlement européen (assistant
parlementaire…) et à la Cour de Justice. Comme nous
l’avons déjà pu montrer (cf. Conseil aux étudiants),
les bureaux régionaux représentent une autre alternative
et parfois même un tremplin.
Enfin, un secteur encore peu connu et plutôt inexploré
en France mais largement répandu dans les pays anglo-saxons,
est celui des entreprises de consulting. Elles existent aussi dans
les pays candidats. Ces firmes ont un besoin accru de personnes
compétentes au niveau communautaire. Leurs activités
sont diverses et peuvent par exemple consister à renseigner
les organismes ou associations régionaux sur la politique
régionale pour les aider à mieux gérer l’attribution
et la mise en œuvre des fonds.
Finalement, l’importance de l’aspect relationnel a été
souligné : une fois entré dans la machine, il est
plus facile de trouver l’emploi qu’on cherche réellement
: de cette manière, un stage se révèle très
utile (se renseigner sur le site de l'UE: www.europa.eu.int)
|