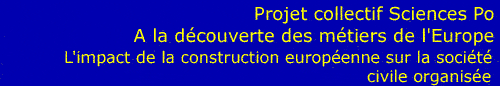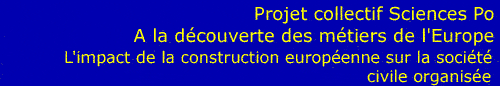|
|
 Entretiens relations extérieures
Entretiens relations extérieures
|
Farida
CHAPMAN, International
Rescue Committee, le 3 avril 2003
|
Est-ce
que je pourrais demander tout d'abord de quel pays vous venez ?
Je suis italienne.
Pourriez-vous définir
votre métier et rapidement décrire les principaux dossiers sur lesquels
vous travaillez ?
En Mars 2001, l'office de l'IRC Belgique s'est ouvert grâce à mon
initiative et mon idée et fin 2001 on est devenu une ONG belge.
Je ne gère pas directement de programme, mais je représente l'ONG
à Bruxelles et j'essaie de maintenir des bonnes relations avec les
bailleurs de fond.
Donc, mes tâches sont plutôt d'une nature administrative et budgétaire,
générale et politique.
Pourriez-vous résumer
votre parcours universitaire?
Quel a été votre parcours professionnel antérieur ? Comment avez-vous
été nommé à ce poste ?
En 1997, j'ai commencé un Master aux Etats-Unis en Relations Internationales.
En même temps, j'ai travaillé à l'école de droit sur les droits
de l'enfant et leur protection dans le cadre d'un groupe de travail
soutenu par le safe the children fund et je me suis spécialisée
dans ce secteur. Puis, j'ai fait un stage d'été à VOICE pendant
3 mois en 1998. C'était un stage administratif. Pendant ce stage,
il se formait une coalition contre les soldats-enfants à Genève
et à New York et j'ai collecté des informations sur cette campagne
dans / par une initiative personnelle. Les membres de VOICE étaient
très intéressés par ce compte-rendu et par mon engagement et ils
m'ont demandé de représenter VOICE aux Etats-Unis. J'ai accepté
bien que ce travail ait été complètement bénévole.
En 1999, j'ai fini mon Master et, en ce moment, ECHO commençait
de s'intéresser également aux enfants-soldats et voulait rendre
cette problématique plus visible à travers une campagne dans des
différents parlements européens. ECHO a alors demandé VOICE d'organiser
cette campagne et comme j'avais fini mon Master et j'étais spécialiste
dans cette matière, VOICE m'a donné un contrat pour 6 mois (avec
une prolongation de 2 mois). En janvier 2000, l'exposition a eu
lieu et était un grand succès.
ECHO voulait lancer une deuxième phase, mais à cause du prix des
droits d'auteurs c'était trop cher.
En avril 2000, j'ai alors commencé de chercher un autre travail
et en juin 2000 j'ai commencé en Sierra Léone comme child protection
officer pour une ONG italienne (COOPI). J'ai passé 9 mois à Freetown
(jusqu'en mars 2001).
Mais je voulais retourner à Bruxelles et comme j'avais remarqué
que l'IRC n'avait pas d'office à Bruxelles, j'ai envoyé mon CV et
une petite étude de faisabilité à l'IRC qui était appréciée
.
Que diriez-vous à un jeune qui souhaite exercer
un métier dans le même domaine que vous ?Existe-t-il des prérequis
ou un parcours obligé ?
Il faut cibler un secteur et s'approprier des skills supplémentaires.
Il faut également montrer son engagement personnel.
BALKANS:
Quel est votre travail
principal?
budget funding, lobbying, information, ...?
Est-ce que vous coopérez avec l'International Crisis Group?
Exactement, ces trois piliers : - budget funding auprès d'ECHO et
de la Commission
- information (dans les deux directions, field > UE et UE >
field)
- lobbying, advocacy
Mais quand je dis représentation, ça veut également exprimer que
je représente les besoins des réfugiés.
On ne demande pas seulement d'argent, parce que - à mon opinion
- il faut aussi y contribuer.
L'IRC est le leader pour la zone grise (zone entre l'humanitaire
et le développement) et elle travaille surtout dans le cadre du
programme CARDS et s'engage pour les enfants dans des conflits armés
(VOICE et safe the children fund sont aussi fortement impliqués.)
Oui, on utilise de temps en temps
les études de l'ICG qui bénéficie d'une grande crédibilité à Bruxelles.
Mais les relations entre l'ICG et nos offices à Londres et à New
York sont plus étroites.
Quels sont les acteurs
(institutionnels et société civile) avec lesquels vous coopérez
pour arriver à vos fins ? Et quel est l'impact de ces acteurs sur
votre travail ?
Comme on est une ONG belge, on coopère surtout avec les institutions
belges et dû à ma nationalité avec les Italiens.
La nationalité de l'ONG est importante.
Avec quels acteurs
est-ce que vous avez des bonnes relations ? Avec lesquels est-ce
que vous avez plutôt des relations conflictuelles ?
ECHO est l'agence de la Commission qui marche le mieux. Elle est
sensible aux besoins des ONGs, parce que la plupart de son staff
a des expériences professionnelles d'ONG. ECHO coopère le mieux.
ECHO a ses field experts sur place pour l'évaluation et le contrôle
des ONGs et pour échanger l'information.
ECHO et VOICE sont nées la même année.
VOICE est le seul interlocuteur pour ECHO et bénéficie d'un mandat
spécial. ECHO consulte VOICE quand il s'agit de nouveaux contrats
avec des nouvelles ONGs.
Pour des petites questions, je consulte ECHO directement, mais p.ex.
en ce moment avec la crise en Irak, ECHO est si surchargée qu'on
ne peut pas les contacter directement, mais VOICE nous envoie chaque
jour un update.
Avec le staff de la DG Relex, j'ai
des expériences ambiguës. Les gens qui s'occupent des droits de
l'homme sont magnifiques, mais …
Ce n'est plus la DG Relex qui gère les fonds, mais maintenant EuroAid.
La DG Relex n'est responsable que pour la policy est les lignes
directrices.
Une réforme / tendance nouvelle est
la déconcentration, c'est-à-dire la Commission consulte sa délégation
sur place. Le premier programme pilote a lieu en Bosnie où la délégation
de la Commission sur place effectue la sélection des partenaires
(système décentralisé). Sur place, elles connaissent mieux la situation.
L'IRC commence déjà à ne plus présenter les papers à Bruxelles mais
sur place auprès des délégations.
L'IRC est une ONG
belge, mais fait partie du réseau de l'IRC. Comment ce fait se montre
dans votre travail ?
Chaque office / ONG est indépendante et est gérée par un conseil
d'administration.
L'IRC n'est pas organisé comme p.ex. CARE, dont chaque filière mène
ses propres projets sur le terrain. Ainsi, des duplications sont
inévitables.
Tous nos offices contribuent au même programme sur le terrain -
notamment New York, Londres, Bruxelles et notre office en Hongrie
qui va prochainement être ouverte.
L'objectif est une spécialisation de chaque office : Londres pour
le post-conflit et la zone grise; Bruxelles pour la région des Grands
Lacs.
Ce principe d'organisation nous aide à économiser l'argent.
A Bruxelles, on est à 2 dans l'office.
L'office à Londres a connu une très grande expansion de 300% l'année
dernière avec maintenant 8 personnes qui y travaillent. C'était
possible grâce au soutien venant d'ECHO.
En Belgique, une ONG doit attendre
3 ans pour être accréditée et pour avoir accès à un accord de cadre
avec le gouvernement. Nous, on est maintenant à mi-temps (après
1,5 ans). Avec un soutien régulier du gouvernement belge, on pourrait
aussi envisager un élargissement de notre office.
Est-ce qu'il y a
une différence entre le travail à Bruxelles, à New York, dans le
terrain, … ?
En gros, non. Mais il faut connaître les mots clés, qu'il faut utiliser
auprès des institutions (p.ex. à New York post-conflict et à Bruxelles
zone grise).
Il existe une similitude entre le travail à New York et à Bruxelles,
parce qu'il faut toujours agir sur deux niveaux - auprès des Etats-membres
et l'institution (notamment l'ONU et l'UE).
Est-ce qu'existe-il
en ce moment un désaccord entre l'IRC et l'UE ?
Il y avait un problème avec le programme CARDS et les policies dans
les Balkans concernant la transparence des contrats. Il n'existait
pas de dialogue structuré entre la Commission et les ONGs et en
demandant des questions précises l'IRC a initié un tel dialogue
avec l'EuropeAide et la DG Relex qui étaitent et sont très ouvertes
à ce dialogue.
Elles favorisent surtout un dialogue sur place, mais l'IRC demande
aussi une coopération plus politique à Bruxelles avec plus de consultations
et de transparence, parce que p.ex. pour la rédaction de la nouvelle
version des country strategy papers, la Commission consulte parfois
des ONGs et parfois non. Les critères de sélection des interlocuteurs
etc. ne sont pas évidents.
L' IRC est finance par l'UE, le gouvernement
hollandaise, l' UNHCR etc.
Quelle influence exercent ces institutions sur
votre travail ?
Toute est politique et le plus important, c'est de sauvegarder l'espace
humanitaire.
Certainement, les bailleurs de fond ont des objectifs, mais la nature
des ONGs est de rester indépendante. Pour cela, elles essaient de
diversifier leurs fonds et de jouir de différents bailleurs et d'un
large base de fonds privés / d'individus.
Le but est l'exemple de MSF avec 80% de son budget financé par le
privé.
Cette indépendance est aussi nécessaire
pour avoir la marge de s'occuper également des crises oubliées,
notamment en Uganda, au Kongo (avec le plus haut taux de mortalité
du monde).
Mais ECHO est normalement consciente de ces crises.
Comment la période
de transmission affecte-elle votre travail?
L'IRC travaille dans les Balkans depuis la guerre, d'abord surtout
dans le secteur de l'infrastructure, et maintenant surtout en ce
qui concerne le capacity building, aussi une priorité de la Commission
et du programme CARDS. Il faut construire une société civile.
En Bosnie, l'IRC a un office local
avec des employés locaux (le cas idéal). La transmission de la capacité
rend possible la continuation du travail. Les objectives généraux
sont: une économie plus stable, les droits de l'homme, faire confiance
dans les institutions.
Pour les ONGs locales, il est très
difficile d'avoir accès aux fonds de l'UE, parce qu'elle demande
des obligations très lourdes, p.ex. des garanties bancaires.
Par conséquent, l'IRC agit comme
"chaîne de transmission" et un bailleur interne ("les umbrella grants").
L'IRC reçoit des fonds pour un projet et effectue soi-même une sélection
et distribue ses fonds à des ONGs locales.
NB : Le contenu de cet entretien
reflète des points de vue personnels mais n'engage pas le IRC
|
|
CARL
HALLERGARD, policy unit SG/HR de Solana,
ancien chef de cabinet de la représentation de l'UE à Skopje, ancien
de ECHO
|
|
Fonction
Suédois d'origine, Carl Hallergard travaille
depuis 2000 à l'unité politique du Secrétariat Général du Conseil
de l'Union européenne, autrement appelée UPPAR, Unité de Planification
de la Politique et d'Alerte Rapide. Cette unité a été créée lors
du traité d'Amsterdam, en même temps que le poste de Haut Représentant
pour la PESC, occupée depuis l'automne 1999 par Javier Solana. Elle
se compose d'un représentant par Etat membre, d'un représentant
de la Commission, M. Hallergard en personne, et de 3 ou 4 représentants
du SG du Conseil. Son mandat est défini dans la Déclaration N°6
du traité d'Amsterdam, et son but est d'assister M. Solana dans
différents domaines de la PESC, essentiellement par l'intermédiaire
de policy papers. Il s'agit en effet de proposer des actions de
l'UE dans le domaine de la PESC. Carl Hallergard reprend les propos
d'Hubert Védrine, soulignant qu'il n'y pas "une politique unique
mais une politique commune" dans le deuxième pilier, pour mettre
en exergue la difficulté de son travail qui consiste à expliquer
aux Etats pourquoi l'Union a intérêt à avoir une PESC et à la développer.
De même, le partage d'informations, même confidentielles, est indispensable
pour une meilleure analyse. En ce qui concerne la chaîne de transmission,
l'idée de départ émane des ministères des Affaires Etrangères et
des délégations de la Commission sous la forme de télégrammes diplomatiques.
Dans la pratique, les informations contenues dans ces derniers sont
partagées de façon variée, mais quoiqu'il en soit, travailler au
policy unit signifie exercer une fonction de soutien du représentant
sur différents dossiers, et compte tenu des informations possédées.
Parcours universitaire
et professionnel
C'est après avoir étudié à l'Ecole de
Commerce de Stockholm puis à l'université en Suède en science politique
et philosophie, que M. Hallergard passe un an au fameux Collège
d'Europe à Bruges, l'année même où la Suède fait son entrée dans
l'Union européenne. Il fait ensuite un stage de 5 mois à la Commission,
dans le Cabinet de la Commissaire suédoise, pour s'occuper de dossiers
du 3ème pilier. Cette première expérience professionnelle est complétée
par 4 ans au sein de l'Office Humanitaire de la Commission, ECHO.
Au regard de ce parcours plutôt " classique ", M. Hallergard nous
avoue ne pas avoir envisagé travailler dans un environnement proprement
européen avant son passage à Bruges. Ce n'est qu'à partir de ce
moment là, et manifestement motivé par l'entrée de son pays dans
l'Union, qu'il s'oriente vers une carrière proprement européenne.
Il est intéressant de noter qu'il n'existe pas de procédure de sélection
prédéfinie pour être recruté à l'UPPAR. Une fois l'unité constituée,
ce sont les Etats membres qui proposent leurs candidats, lesquels
sont sélectionnés par le Haut Représentant lui-même. Il s'agit donc
d'une unité très particulière dans la mesure où son mandat se termine
avec celui du Haut Représentant, en l'occurrence fin 2004, pour
laisser la place à une nouvelle équipe.
Selon lui, travailler dans le domaine de la PESC nécessite une solide
expérience dans son administration nationale, c'est-à-dire principalement
travailler au Ministère des Affaires Etrangères pendant quelques
années puis en ambassade. Il est également envisageable d'aborder
le métier par les institutions-mêmes, puisque celles se caractérisent
par essence par une mobilité forte. Ces deux approches, soit nationale
soit européenne, impliquent bien sûr de présenter les concours,
lesquels doivent, selon M. Hallergard, n'être envisagés que comme
des alternatives parmi d'autres. Mais il existe selon lui une approche
différente qui mérite toute notre attention. En effet, la voie d'accès
par les ONG, les think tanks, les lobbies ou encore les cabinets
de consulting, si elle semble peu prisée pour le moment, notamment
dans le domaine de la PESC et plus généralement de la politique
européenne dans le Balkans, s'avère être porteuse d'avenir. M. Hallergard
mise ainsi beaucoup sur le développement de ce cercle d'organisations
qui gravitent autour des institutions et qui sont, selon lui, amenées
à être de plus en plus intégrées, à l'image du système américain.
Cette dernière option n'est donc pas négligeable pour accéder à
un poste de cette stature.
Position et rôle
dans la chaîne de transmission de la politique dans les Balkans
M. Hallergard part d'un exemple concret
pour bien nous montrer la spécificité de sa position et de son rôle
dans la chaîne de transmission dans la définition et la mise en
œuvre de la politique européenne dans les Balkans. Lorsqu'il
s'agit de lancer une opération militaire, la chaîne de transmission
est clairement définie : on réfléchit avec les militaires, puis
on planifie une opération, ce qui suppose l'élaboration d'un document
officiel présentant et défendant cette opération afin qu'elle soit
lancée, ce qui se traduit concrètement sur le terrain. Les choses
sont tout à fait différentes dans le domaine de la PESC car il y
a toujours une politique, des actions passées qu'il faut bien entendu
prendre en considération. La difficulté réside donc dans l'application
d'une politique nouvelle dans le contexte d'une situation qui émerge
et à laquelle il faut faire face.
Il nous donne l'exemple de la Serbie-Monténégro. Lors de la Présidence
portugaise en 2000, l'Union a déclaré qu'elle, ainsi que les autres
pays des Balkans occidentaux, fait partie des candidats potentiels
à l'adhésion. On se trouve dès lors dans la première phase de la
politique européenne à l'égard de ce pays. Néanmoins, Solana et
son cabinet veulent poursuivre leur politique dans les Balkans en
se prononçant contre l'indépendance du Monténégro et par conséquent
pour le maintien de l'unité entre les deux entités. A partir de
cette idée de base, il s'agit alors de présenter un document justifiant
cette politique pour que celui-ci soit ensuite discuté au sein du
Conseil des ministres. Eventuellement, les conclusions adoptées
peuvent comporter un mandat pour voyager et faciliter les négociations
entre la Serbie et le Monténégro. Néanmoins, la mise en œuvre
est souvent très longue. De plus, des événements comme récemment
l'assassinat du premier ministre serbe viennent sans cesse remettre
en question la politique poursuivie et provoquer des changements
d'attitude délibérés ou non. Quel est l'impact d'un tel acte ? Faut-il
réfléchir autrement la politique vis-à-vis de ces pays ? Pour certains
dossiers comme le statut final du Kosovo, les choses sont prévisibles
par contre et il est donc possible de les anticiper. Ainsi, les
Kosovars étaient très pressés de régler cette question avant l'assassinat
du premier ministre, mais le Conseil est demeuré ferme dans sa position
et a souligné la nécessité au préalable de remplir tous les critères.
En résumé, le SG et plus précisément l'UPPAR semblent se situer
à différents niveaux du processus de décision, mais il serait peut
être plus exact de le situer dans la phase prise de décision et
mise en œuvre que réellement développement.
Partenaires et nature
des relations entretenues avec ces derniers
S'occuper de la politique européenne
dans les Balkans, c'est avant toutes choses travailler avec les
pays de la région concernée, ces derniers étant donc des interlocuteurs
de premier plan que l'on oublie trop souvent de citer : l'ARYM,
la Serbie-Monténégro, etc. Il est donc important de connaître ces
pays pour les conseiller et les influencer, même s'il faut bien
reconnaître qu'en période de crise ces pays abritent des " acteurs
positifs " désireux de collaborer, et des " acteurs négatifs ".
Ensuite, l'unité est en lien direct avec
les Etats membres qui décident au Conseil mais également avec la
Présidence qui a la charge importante de définir le programme et
de présider les groupes de travail. Le Haut Représentant et la Présidence
proposent aux Etats une politique européenne dans les Balkans mais
les divergences nationales supposent la recherche incessante de
compromis, ce qui suppose une certain degré de justification et
de négociation de la part du SG. Si cela n'est déjà pas une tâche
aisée, il est encore plus délicat de faire ensuite en sorte que
les Etats collectivement s'entendent avec la Commission.
Celle-ci compte bien entendu parmi les
interlocuteurs privilégiés de l'unité politique car il est vital
que la politique de M. Solana soit en accord avec le travail de
la Commission, et notamment avec le Processus de Stabilisation et
d'Association dont elle a la responsabilité. Il y a donc une obligation
évidente pour M. Patten et M. Solana de se mettre d'accord sur les
grandes orientations de politique étrangère dans les Balkans. La
Commission et l'unité politique participent souvent à des missions
communes comme ce fut précisément le cas la veille à Belgrade. A
la question de savoir s'il existe des rivalités avec la Commission,
M. Hallergard nous explique qu'il ne peut exister " d'harmonie absolue
" mais qu'il y a " une entente certaine ". Le rôle joué par les
deux personnalités que sont Solana et Patten est crucial car ce
sont eux qui donnent le ton à tout le monde par leur bonne entente.
La coopération entre les deux institutions fonctionnent donc bien,
ce qui n'est pas " grâce au système ", nous dit-il, mais plutôt
" malgré le système ".
Les organisations internationales sont
également très présentes dans le terrain des Balkans et constituent
par définition des acteurs partenaires: ONU, OSCE, OTAN, Conseil
de l'Europe. Si les buts sont plus ou moins commun, le chemin pour
y parvenir peut diverger, il y a donc encore une fois nécessité
de s'accorder. Les choses sont d'autant plus compliquées que tous
les Etats membres sont membres de ces organisations et qu'ils doivent
donc se coordonner en leur sein également. Si l'on parle parfois
de rivalités avec l'OTAN dans le théâtre des Balkans, c'est à la
fin toujours aux Etats membres de décider si l'opération militaire
sera lancée par l'Otan ou l'UE. Cependant, il s'agit selon M. Hallergard
d'une relation relativement nouvelle, entre deux organisations relativement
puissantes, et celle-ci est donc amenée à se clarifier peu à peu.
Le jeu d'influence du SG est plus important sur le terrain, dans
la mise en œuvre et la gestion, une fois que la décision de
lancer une opération est fermement prise. Les exemples de la Macédoine
et de la Bosnie sont révélateurs. La question de savoir si l'UE
va prendre la relève militaire de l'OTAN en Macédoine nécessite
non seulement le consensus des 15, mais également de prendre en
compte les positions des acteurs impliqués plus ou moins directement
comme l'OTAN, l'OSCE, les USA, l'UE. La question est encore éminemment
politique et délicate lorsque l'on considère la mission policière
en Bosnie. Dans cette première phase de prise de décision, le SG
et l'unité politique ont peu d'influence vis-à-vis de l'OTAN. Par
contre, ils en ont bien plus pour ce qui de la mise en œuvre
et de la gestion. En ARYM/Macédoine par exemple sont présents le
Représentant Spécial, la Commission, le Moniteurs de l'Union européenne
(EUMM), ECHO ainsi que de nombreux autres acteurs et les ambassadeurs
des Etats membres. .
En ce qui concerne les relations que l'UPPAR entretient avec les
ONG, celles-ci sont relativement peu structurées et fortes. En effet,
elles n'ont pas un impact direct dans la mesure où elles sont absentes
du processus de décision. Elles peuvent toutefois exercer une influence
variable à travers leurs rapports. Si ces derniers s'avèrent utiles
et intéressants, les rédacteurs peuvent être invités pour une discussion,
ce qui n'a pas une portée exceptionnelle. Par exemple, M.Hallergard
se souvient avoir été en désaccord total avec le European Stability
Initiative sur la crise économique de 2004. D'autres acteurs extérieurs
participent donc indirectement à la politique européenne dans les
Balkans, notamment des think tank comme International Crisis Group,
dont l'influence elle est amenée à s'accroître.
Son expérience précédente
: chef de cabinet à la représentation à Skopje
ECHO task manager on refugee return issues
Carl Hallergard a également travaillé
à Skopje pour Alain Roy, Représentant Spécial de l'UE, qui a succédé
à François Léotard, nommé pour négocier les accords d'Ohrid. Ainsi,
les liens entre le Haut Représentant et son équipe de même qu'entre
le Haut Représentant et le Représentant Spécial sont privilégiés.
La représentation à Skopje est composée d'une équipe de 6-7 diplomates
détachés des Etats membres et qui travaillent dans des domaines
différents. Carl Hallergard occupe alors le poste de chef de cabinet
en charge de l'organisation du Bureau et des liens avec la SG. Sa
tâche était donc de faciliter la mise en oeuvre des accords d'Ohrid
signés en octobre. Dans le cadre de ses fonctions à Skopje, M. Hallergard
nous dresse un tableau schématique de ses liens avec ses partenaires,
en comparaison avec sa fonction à Bruxelles :
-Skopje : 60% avec les autorités locales - Bruxelles : 50% avec
les Etats membres
30% avec les Organisations internationales 30% avec les OI
10% avec les Etats Membres 20% avec les pays
Sur place, il travaille donc avec les
mêmes organisations mais plus précisément avec leur représentant
: ex : le représentant de la force de l'OTAN. Et dans le cadre de
l'opération Concordia, le bureau de l'OSCE, l'OTAN, la Commission,
le bureau du Conseil de l'Europe, Le Haut Commissariat aux Réfugiés,
la présidence de l'UE et les ambassadeurs restent les principaux
acteurs de rang international.
En ce qui concerne la politique autonome
de l'Union développée dans les Balkans, il faut noter que l'impact
de la PESC ne se mesure pas à Bruxelles mais sur le terrain. Dans
le cadre des accords d'Ohrid, l'UE coordonne le tout et son autorité
est respectée par tous, y compris l'OTAN. Le chef de file à Skopje,
c'est-à-dire le représentant spécial directement nommé par Solana
bénéficie d'autre autorité sans faille sur le terrain. C'est d'ailleurs
là que l'évaluation d'une politique est la plus pertinente, dans
la perspective locale : l'accueil du Représentant de Solana dans
ces pays par les presses locales, les habitants, les leaders locaux
est tout à fait révélateur de l'aura dont l'UE bénéficie. Si le
fonctionnement au niveau local de la PESC dans les Balkans semble
optimal, il existe un grand contraste néanmoins avec la position
de l'Union sur la scène internationale, sur des dossiers comme l'Irak,
où la définition d'une politique commune s'avère malaisée.
Ce qui soulève la question de l'enjeu que représentent les pays
des Balkans pour des organisations comme l'OTAN ou l'UE. En effet,
dans les Balkans (et à l'Est en général), tous les pays veulent
adhérer à l'OTAN, qui a donc une influence indéniable sur ces pays
avec une situation géostratégique essentielle, mais il est à noter
que ces mêmes pays souhaitent tout autant adhérer à l'UE. Par conséquent,
quand les deux entités ont des points de vue différents, cela pose
nécessairement des problèmes. Mais cela ne signifie pas pour autant
que l'entrée dans l'OTAN ou dans l'UE s'exclue mutuellement. Au
contraire, adhérer à l'OTAN peut sembler plus facile car moins contraignant
pour des petits pays comme ceux des Balkans, et constituer en outre
un argument de poids pour poser sa candidature à l'adhésion de l'UE.
En bref, l'OTAN est un acteur politique clé même s'il n'a pas de
politique étrangère en tant que telle.
|
|
Dominique
LAPRAND, DG Relations extérieures, le 3 avril 2003
|
| Pourriez-vous
définir votre métier et rapidement décrire les principaux dossiers
sur lesquels vous travaillez ?
Je travaille comme END (Expert National
Détaché) à la DG RELEX à la Commission, qui est une interface politique
entre les différentes DG mais également entre les institutions et
les autres acteurs extérieurs qui s'occupent des Balkans. Ma fonction
est de développer les politiques et programmes d'assistance pour
transformer la politique et les institutions des pays des Balkans
dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (police).
En réalité, mon poste n'existait pas et il a donc fallu que je définisse
moi-même mon métier au sein de la Commission, en ce sens on peut
dire que je suis un " précurseur " ! En effet, j'ai du à la fois
faire l'inventaire des mesures déjà mises en place, puis définir
une stratégie et la communiquer, un travail de longue haleine qui
s'est déroulé sur trois ans, la troisième année étant celle de la
première évaluation de la mise en œuvre des programmes créés.
Pourriez-vous résumer
votre parcours universitaire ? Quel a été votre parcours professionnel
antérieur ? Comment avez-vous été nommé ou recruté à ce poste ?
Après avoir fait Saint-Cyr et servi
dans l'armée, j'ai passé le concours de la Gendarmerie, tout en
faisant en parallèle une licence de droit, et suis entré à l'Ecole
de Guerre pour la Gendarmerie. J'ai également suivi les cours de
l'académie du FBI, de l'institut des Hautes Etudes de la Sécurité
Intérieure (IHESI). C'est à l'Université de Dauphine que j'ai réalisé
un DEA de sociologie des organisations, sur " La dynamique sociale
du changement " plus exactement, ce qui me fut très utile pour travailler
ensuite sur la Bulgarie et les Balkans.
En ce qui concerne mon expérience
professionnelle, j'ai d'abord été officier de Gendarmerie en France,
chargé de fonctions d'encadrement, où je suis passé d'une position
de "middle management" à celle d' "executive position". Au cours
de ma carrière française j'ai également servi au ministère de la
Justice où j'ai traité des questions de police judiciaire. J'ai
ensuite été expert sur la Bulgarie dans le cadre du programme PHARE.
En effet, la Commission a fait un appel d'offre auprès des Etats
membres pour recruter des experts en matière de police, et j'ai
donc eu l'occasion de faire ainsi une mission d'évaluation de 10
jours, ce qui fut mon premier contact avec la Commission. Il s'agissait
alors de faire une évaluation et des recommandations. Pendant une
année, en plus de mes fonctions françaises j'ai poursuivi ce travail
en définissant un projet de modernisation de la police bulgare.
Ce projet a donc donné lieu a un appel d'offre lancé par la Commission
et remporté par les Espagnols. J'ai par ailleurs travaillé avec
la Commission dans le cadre du programme CARDS car elle recherchait
des personnes expérimentées dans le domaine JAI, et notamment dans
le développement des anciens pays communistes de l'Est, et ayant
de bonnes connaissances du travail communautaire. Le recrutement
s'est donc fait par le bouche-à-oreille puisqu'il s'agissait de
sélectionner des experts dans ces matières spécifiques. J'ai ainsi
obtenu le statut d'Expert National Détaché à la Commission (END),
mais je reste colonel de gendarmerie dans le cadre national.
Votre formation vous destinait-elle à exercer un métier de l'Europe
? Et quelles sont vos perspectives de carrière à moyen et long terme
(cadre national ou européen) ?
En conséquence, rien ne me prédestinait
à ce poste à la Commission car c'est vraiment moi qui l'ai créé
de toutes pièces, en jouant si l'on peut dire un rôle de précurseur.
A terme, une fois que la période " normale " d'environ 4 ans sera
finie à la Commission car la " boucle sera bouclée " (1ère année
: inventaire ; 2ème année : définition de la stratégie ; 3ème année
: communication de la stratégie et premières évaluations), j'envisage
éventuellement de rester dans un cadre européen ou international,
et surtout compte tenu de la nature de la situation française actuelle
dans laquelle la direction de la police, comme fonction, est accaparée
par le corps préfectoral. Par exemple, les institutions européenne
comme d'ailleurs le Pacte de Stabilité, l'OSCE et l'OTAN recherchent
de nombreux experts de police et c'est une perspective qui pourrait
m'intéresser.
Que diriez-vous à
un jeune qui souhaite exercer un métier dans le même domaine que
vous? (Par ex. existe-t-il des pré requis ou un parcours obligé
pour exercer votre métier ?)
Avant tout, il est important d'avoir
un background professionnel de qualité pour être bon dans un domaine
technique. De même, on ne le dira jamais assez mais la maîtrise
de l'anglais est fondamentale. Même si j'ai passé du temps aux Etats-Unis
et ai pu acquérir un anglais courant, j'avoue avoir dû prendre à
la Commission des cours de langues spécialement conçus pour les
fonctionnaires et notamment pour la rédaction administrative qui
est une tâche très spécifique. De plus, il ne faut pas oublier que
les concours communautaires impliquent nécessairement une épreuve
dans une langue communautaire autre que sa langue maternelle.
On peut alors passer au cœur du sujet,
à savoir les Balkans. Si vous devriez décrire la chaîne de transmission
de la définition et de la mise en œuvre de la politique de
l'Union européenne dans les Balkans, à quel point de cette chaîne
vous situeriez-vous ? Quel rôle jouez-vous dans cette chaîne de
transmission ? (On se concentre plus particulièrement sur les 3
périodes de l'élaboration d'une politique : développement/prise
de décision/mise en oeuvre)
Toute politique commune peut être
vue comme une boîte, une boîte dont il reste à déterminer le format,
le(s) destinataire(s) et la façon dont on la transmet à ce(s) destinataire(s).
Toute chaîne de transmission se définit comme suit : état/situation
=) analyse =) élaboration de la politique et du programme adéquat
=) mise en œuvre, ce que vous résumez, vous, par " développement/décision/mise
en œuvre).
Pour définir ma fonction et ma place dans la chaîne décisionnelle,
je dirais que je suis " initiateur-animateur " car il y a dans mon
métier un côté " entrepreneur " mais je ne vais jamais jusqu'à la
réalisation concrète, confiée à une autre direction générale. Mon
rôle se limite au jeu politique. En d'autres termes, il faut souligner
que la DG RELEX n'est pas impliquée dans la dernière phase que vous
évoquez, celle de mise en œuvre. Son action se situe plutôt
au niveau des deux premières étapes où il s'agit de faire émerger
une idée au sein du Conseil et de la Commission avant de la communiquer
et de la défendre auprès des Etats membres. La DG RELEX, comme la
DG JAI avec qui nous travaillons beaucoup, sont des DG dont la mise
en œuvre est éminemment politique : les choix sont politiques
à chaque étape (savoir si la politique est compatible avec Schengen,
avec le système américain, avec Europol, etc) ce qui constitue bien
sûr une faiblesse du fait du manque d'intégration. Conduire une
politique c'est faire face à des obstacles en assurant la coordination
la plus grande et la plus efficace.
Quels sont les acteurs
avec lesquels vous coopérez pour arriver à vos fins ? Comment les
influencez-vous ? Et quel est l'impact de ces acteurs sur votre
travail ?
Pour bien comprendre l'environnement
européen et les acteurs qui le composent, il faut garder à l'esprit
un schéma très simple, celui de l'existence de trois cercles concentriques.
En effet, au centre nous avons les institutions européennes, celles
qui sont officiellement responsables des politiques et chargées
de veiller à leur mise en œuvre. Autour de ce premier cercle
viennent graviter des organes comme les représentations des Etats
(membres, candidats, pays tiers), les comités (des Régions, Economique
et Social, etc) . Enfin, ONG, lobbies, think tanks sont tous les
organes qui cherchent à influencer ces premiers cercles de façon
plus ou moins directe. La DG RELEX a donc bien évidemment des contacts
avec tous ces acteurs pour développer sa politique européenne dans
les Balkans.
En premier lieu, et au niveau de
ce premier cercle, nous entretenons de nombreux contacts avec la
JAI bien sûr, qui s'occupe de a lutte contre le crime organisé et
qui relève d'un pilier intergouvernemental. Nous collaborons aussi
beaucoup avec le Conseil et plus particulièrement l'unité politique
du Secrétariat Général (M. Hallergard notamment) et avec M. Solana.
Mais il faut prendre en compte que les intérêts défendus peuvent
diverger : la Commission suit l'intérêt communautaire et c'est en
ce sens que la DG RELEX est souvent considérée par ceux qui y travaillent
comme une " citadelle assiégée " qui a du mal à forger des compromis,
même si je dois avouer que ma position d'END me place un peu à part.
Au niveau institutionnel tout d'abord, il y a donc deux acteurs
clés dans cette politique des Balkans : le Conseil de l'Union à
travers la policy unit en charge de la PESC et bien sûr le Haut
Représentant pour la PESC M. Solana ; et la Commission, c'est-à-dire
la DG RELEX à laquelle j'appartiens, mais aussi les DG JAI et AIDCO,
ainsi que le Pacte de Stabilité qui sera bientôt " communautarisé
". Les circuits sont différents bien entendu mais le problème majeur
réside dans le manque de communication entre les représentations
des Etats membres, et même au sein de ces mêmes représentations,
pour que les différents circuits se coordonnent.
De plus on peut regretter l'absence
de représentations structurées dans les Etats des Balkans qui, s'ils
s'avèrent sans aucun doute être des interlocuteurs importants, ne
disposent pas toujours des moyens adéquats pour constituer des acteurs
d'un poids égal.
J'ai aussi des contacts fréquents avec les différents représentants
à Bruxelles, de même qu'avec les desks géographiques des Etats des
Balkans concernés auprès desquels je suis un assistant et un conseiller.
Au niveau de chacun de ces Etats, je reste en relation avec le Ministère
de l'Intérieur, de la Justice, avec les Procureurs Généraux et les
Chefs de Police également.
Pour ce qui est de mes interactions
avec ce fameux " troisième cercle ", c'est-à-dire principalement
les ONG et think tanks, il m'arrive de les rencontrer dans le cadre
régional, et notamment certaines réunions sont organisées sur place
avec des ONG s'occupant des droits de l'homme pour savoir quelle
perception la société civile a des services de police sur place.
Le rôle des ONG et leur impact sur le travail de la DG RELEX varient
d'un service à l'autre. Les personnes de la DG qui sont chargées
de consolider la démocratie en renforçant par exemple le rôle des
médias sont plus sensibles aux ONG que moi, ce qui semble évident.
Pour ce qui est de nos sources d'informations, l'International Crisis
Group joue un rôle non négligeable, mais je sais que la compétence
technique dans le secteur JAI est essentiellement délivrée par le
Etats membres, par l'intermédiaire des ministères.
Concernant les acteurs internationaux
qui sont omniprésents dans la région des Balkans, l'OTAN est au
premier plan. Je travaille notamment avec cette organisation sur
la gestion policière des frontières contre les menaces criminelles
(immigration illégale, trafic ou autres). Il faut aussi restreindre
au maximum l'activité des bandes armées autour du Kosovo par exemple
qui veulent s'opposer à l'UNMIK et lutter contre les Serbes. L'intérêt
pour l'OTAN est certain dans la mesure où celle-ci est engagée dans
le partenariat pour la Paix entre l'Albanie et la Macédoine tandis
que l'UE est également impliquée et ce d'autant plus avec sa première
mission en Macédoine. Les Etats membres ont beaucoup poussé, la
France la première, pour que l'UE prenne la relève de l'OTAN. Mais
si globalement il y a convergence de vue avec l'OTAN, les divergences
sont plutôt internes à la Commission car beaucoup ne conçoivent
pas de travailler avec des militaires pour contrôler les frontières
or il y a un besoin réel de contrôle.
Vous vous êtes occupé du SPAI, (Stability
Pact Anticorruption Initiative) et notamment vous avez fait partie
du Managing committee. Ce dernier se compose de nombreux acteurs
que nous venons d'évoquer pour la plupart, le Conseil de l'Europe,
la Commission bien sûr, l'OCDE, l'office du Pacte de Stabilité,
la Banque Mondiale, les USA…Pouvez-vous nous dire en quelques
mots en quoi consiste ce pacte ?
En réalité nous avons plus une approche
judiciaire mais je dois dire que je ne traite plus ce dossier.
Le rôle de l'UE dans
les Balkans est en pleine évolution : à mesure que la région se
stabilise, l'aide d'urgence et l'aide à la reconstruction consenties
par la CE laissent la place à la promotion d'un développement durable
et multiforme, visant notamment au renforcement des institutions.
Ainsi, des programmes comme ECHO sont en train de se retirer peu
à peu (pour laisser place à CARDS ou l'Agence Européenne pour la
reconstruction). Pourriez-vous développer un peu plus ce changement
de stratégie adoptée par la Communauté ? Quelles en sont les conséquences
?
Tout à fait, la Commission est chargée
de mettre en œuvre le programme CARDS et elle doit pour cela
adopter des stratégies particulières. En réalité, il s'agit plus
précisément d'accords d'association, c'est-à-dire que les pays doivent
s'engager à faire des réformes pour obtenir en contrepartie les
fonds de l'assistance CARDS. Il existe à ce titre des programmes
nationaux et des programmes régionaux.
Il s'agit en fait plus pour la Commission d'une étape, d'une transition
et ce changement de stratégie est impulsé par le contexte et la
stabilisation progressive de ces régions.
Si l'on prend l'exemple de la Macédoine, c'est le premier accord
de stabilisation qui a été signé car il s'agissait à l'époque d'aller
vite et de privilégier l'aspect politique et symbolique de ce geste
sur la substance. Lorsque la crise a éclaté en Macédoine, les problèmes
ont surgi et comme la Commission était très impliquée, elle a du
débloquer un mécanisme de réaction rapide pour mobiliser des fonds
dans le court terme pour répondre aux besoins les plus pressés.
En Bosnie par contre, le leadership est passé au Conseil avec la
mission de police prise en charge par l'UE.
En fait, le problème avec les Balkans, c'est que des décisions variées
sont mises en œuvre selon des logiques différentes. Plus généralement,
l'UE se trouve dans ce cas précis dans une posture différente :
il ne s'agit plus aujourd'hui de reconstruire la région mais consolider
la démocratie en renforçant les institutions. On entre là dans la
phase la plus délicate, car il faut pouvoir et savoir gérer le changement.
|
|
Sorin
STERIE, pacte de stabilité, le 3 avril 2003
|
|
Tout d'abord, on
voudrait vous demander votre nationalité.
Roumaine
Est-ce que pous pourriez
rapidement définir votre profession et évoquer les pincipaux dossiers
sur lesquels vous travaillez?
A la base je suis un diplomate travaillant pour le Ministère des
Affaires Etrangères roumain. Je suis expert en questions de sécurité
au Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Je suis surtout
responsable pour les affaires de justice et les affaires intérieures.
Mon travail se concentre sur l'application du droit, la lutte contre
le crime organisé (initiative SPOC), contre la corruption (initiative
SPAI), contre le terrorisme et pour la coopération et la formation
des forces de police.
Pourriez-vous résumer votre éducation universitaire? Est-ce que
cette éducation vous a automatiquement conduit vers un "métier de
l'Europe" ?
Mes études n'ont pas forcément été très typiques. En fait je suis
un ingénieur. Je suis diplômé de l'Université Technique de Bucarest
et de la faculté de droit de Timisoara. J'ai égalemet accompli un
master en Droits de l'Homme sous les auspices des Nations Unies.
Quelle a été votre
carrière professionnelle antérieure ?
J'ai commencé à travailler comme ingénieur dans une usine de mécanique
fine, qui a produit pour l'armée. C'est ainsi que je suis venu à
l'agence nationale pour le contrôle des exportations stratégiques,
qui a été incluse dans les services du Premier Ministre. Après une
réforme en 2000, l'agence a été transférée au Ministère des Affaires
Etrangères. En tant que coordinateur national des affaires de sécurité
je suis alors devenu candidat au poste d'expert au Pacte de Stabilité.
On peut alors en
venir au cœur de notre sujet: La politique de l'UE dans les
Balkans. Un grand nombre d'organisations internationales et de pays
sont impliquées dans le Pacte de Stabilité, ce qui rend difficile
la compréhension de son fonctionnement. Pouvez-vous expliquer comment
marche la coordination?
Au départ le Pacte de Stabilité a été conçu comme une sorte de "toit"
pour tous les acteurs impliqués dans les Balkans. Il faut se rappeler
que le Pacte de Stabilité n'est pas une institution et non plus
une organisation, mais un accord, une initiative. Donc le Pacte
peut agir en tant que coordinateur. Mais il y a bien sûr des problèmes,
car certains essaient de nous marginaliser. Mais l'initiative a
l'avantage qu'elle ne concerne pas que les Etats de l'Union, mais
tous les pays, incluant donc p.ex. les Etats-Unis et la Norvège
ainsi que les organisations actives dans la région. Le Pacte de
Stabilité peur favoriser des accords entre gouvernements. Les donateurs
veulent savoir ce qui a déjà été fait dans la région et ce que d'autres
sont en train de faire. Donc ils viennent chez nous s'ils ne veulent
pas rester à un niveau bilatéral. Notre avantage est que tous sont
des partenaires du Pact; nous assurons par notre coordination que
tous ne font pas la même chose! Le dialogue entre les "joueurs régionaux"
est crucial, car si nous oublions quelqu'un, cela peut poser des
problèmes plus tard. C'est ce que font les 20 experts travaillant
ici.
Comment coopérez-vous
avec la Commission?
Il y a certaines complémentarités. La Commission couvre seulement
les Etats membres et les Etats candidats. Bien évidemment elle dispose
d'une section pour les Balkans, mais ils n'ont pas de personnel
pour tout à la DG Relex. Les mécanismes internes à la Commission
sont plutôt compliqués, mais nos contacts avec eux sont bons. Le
développement des Balkans est devenu une priorté depuis le signal
politique délivré sous la présidence grecque: tous les pays de l'Europe
du Sud-Est deviendront membres de l'Union dans l'avenir.
L'UE a un rôle de
leader dans le Pacte de Stabilité, mais elle n'est pas la seule
organisationn internationale impliquée. Qui fixe l'ordre du jour?
Quel est le poids de l'UE comparé à celui des Etats-Unis, l'OTAN
etc.?
L'UE est certainement la forces motrice derrière le Pacte. Mais
l'UE n'a pas d'armée, donc pour les affaires militaires nous discutons
avec l'OTAN et la Banque Mondiale. Cette dernière aide à soutenir
le processus souvent douloureux qui vise à reconvertir les bases
militaires régionales, ce qui a beaucoup de conséquences sociales
et économiques. Il faut chercher des utilisations civiles (hôpitaux,
centres commerciaux etc.) pour les anciennes bases militaires.
Quels sont les autres
acteurs avec lesquels vous travaillez?
J'ai déjà évoqué la Commission et les autres organisations internationales
(tels que l'OSCE). Je peux aussi évoquer les coordinateurs nationaux
des différents pays - les pays donateurs et receveurs. Il y a également
certaines ONG tels que " Saferworld ", un think tank basé à Londres
qui fait du lobbying en matière de sécurité (lutte contre le terrorisme
et le crime organisé). Une perception fausse - mais fréquente -
est celle d'un Pacte de Stabilité qui distribue de l'argent. Les
gens ne savent souvent pas que le Pacte lui-même n'a pas d'argent
à donner! Cette mauvaise perception est largement due à une certaine
propagande au des débuts, lorsque certains ont présenté le Pacte
comme "deuxième Plan Marshall". En fait, dans le cadre du Pacte,
les problèmes de la région son identifiés, et ensuite les mesures
nécessaires sont prises en proposant p.ex. l'adoption d'une législation
sur certains problèmes, ou la facilitation du dialogue régional,
ou encore l'organisation d'une réunion régionale. Nous avons aussi
des liens étroits avec le Centre régional de lutte contre le crime
transfrontalier à Bucarest.
Vous n'êtes pas un
ressortissant de l'UE. Est-ce que ceci influence votre travail et
vos relations avec les institutions de l'UE? Est-ce que vous vous
voyez comme un acteur d'une politique de l'UE?
Ici aux "working tables" du Pacte, les représentants de l'Europe
du Sud-Est sont les égaux de ceux des organisations internationales
qui fixent l'ordre du jour. Certains de mes collègues viennent de
Croatie, de Macédoine et d'Albanie. En ce qui concerne la politique
de l'UE - oui, je suis impliquée dans cette politique, mais très
indirectement. Et d'une certaine façon je suis impliqué dans un
processus qui favorise l'adhésion future des pays de cette région
à l'Union.
|
|
Nicolas
WHYTE, International crisis group
|
|
Tout d'abord, nous
voudrions vous demander votre nationalité
Britannique et Irlandaise - je suis originaire d'Irlande du Nord.
Est-ce que pous pourriez
rapidement définir votre profession et évoquer les pincipaux dossiers
sur lesquels vous travaillez?
Depuis Mai 2002 je suis le directeur du programme Balkans au International
Crisis Group (ICG). Le ICG est une organisation indépendante visant
à prévenir et à résoudre des conflits à travers une analyse de terrain
et le lobbying de haut niveau. Je suis responsable pour la coordination
de la recherche de l'ICG sur le terrain, les analyses et les recommandations
de politique en rapport avec les Balkans. Je suis à la tête d'un
groupe de 12 personnes travaillant dans la région : quatre agents
travaillant à plein temps à Skopje, Pristina, Belgrade et Sarajevo,
les autres à mi-temps. Ces personnes accumulent des informations
et font des analyses politiques. Pour faire cela ils sont dans une
meilleure position que la plupart des gouvernements, qui ne disposent
pas d'agents sur le terrain. La partie visible de mon travail est
la publication de rapports. La différence par rapport à d'autres
think tanks est que nous avons plus de réunions avec des responsables
et nous défendons davantage nos causes (advocacy) auprès des Etats
membres, des Nations Unies etc. Nous avons beaucoup plus de contacts
avec les gouvernements ainsi qu'avec les médias.
Pourriez-vous résumer
votre éducation universitaire? Est-ce que cette éducation vous a
automatiquement conduit vers un "métier de l'Europe" ?
Je détiens un BA en sciences naturelles (1989), un M Phil en Histoire
des Sciences (1991, Clare College, Cambridge) et un PhD en history
et en philosophie des sciences (1997, Queen's University of Belfast).
Ces études m'ont surtout donné une bonne faculté d'analyse.
Quelle a été votre
carrière professionnelle antérieure ?
Ce qui m'a amené vers l'analyse politique était le fait que j'étais
un activiste politique dans le British Liberal Party et le Ulster
Alliance Party. J'étais recruté par le National Democratic Institute
for International Affairs (NDI), une organisation américaine visant
à renforcer la démocratie dans le monde, qui à ce moment-là voulait
recruter quelques non-Américains. Quand j'ai travaillé pour le NDI,
j'ai vécu en Bosnie et en Croatie en 1997 et 1998. Je suis ensuite
devenu le manager en communication et chercheur au Centre for European
Policy Studies (CEPS) à Bruxelles, où j'étais le principal analyste
pour les Balkans publiant le mensuel Europa South-East Monitor.
Que diriez-vous à
un jeune qui souhaite exercer un métier dans le même domaine que
vous ?Existe-t-il des prérequis ou un parcours obligé ?
Comme le montre mon propre passé académique, il n'y a pas d'éducation
absolument obligatoire. Mais un étudiant doit avoir un grand intérêt
pour la politique. Il devrait aussi avoir eu une activité politique
lui-même.
On peut alors en
venir au cœur de notre sujet: La politique de l'UE dans les
Balkans. Si vous devriez décrire la chaîne de transmission développement-décision-exécution
de la politique de l'Union européenne dans les Balkans, à quel point
de cette chaîne situeriez-vous votre action ?
Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, nous n'intervenons
pas uniquement dans le développement d'une nouvelle politique. En
fait nous intervenons à tous les trois niveaus.
Qui sont les acteurs
impliqués dans la politique de l'UE dans les Balkans avec lesquels
vous travaillez ?
A l'intérieur de la Commission il y a en général une personne qui
joue un rôle de " meneur ". Dans le cas de la Macédoine, mon meilleur
contact était l'ancien conseiller de Chris Patten.
J'ai également de bons contacts à l'Unité Politique du Haut Représentant
pour la PESC.
Ensuite, des partenaires très importants sont les Etats membres
de l'Union : surtout les trois grands (Royaume-Uni, France et Allemagne),
mais aussi le pays qui détient la Présidence. En ce qui concerne
la Présidence, il vaut mieux travailler avec l'expert de la Représentation
Permanente à Bruxelles. Pour les " trois grands ", il vaut par contre
mieux s'adresser directement aux gouvernements nationaux. Dans ce
cas je ne parle pas aux Ministres, mais aux agents des " desks "
sur les Balkans, faisant l'ébauche propositions et des notes de
travail qui sont alors envoyées vers le haut de la chaîne de transmission
au sein du Ministère.
Je dispose aussi de quelques contacts au Parlement européen, même
si cette institution n'est pas très puissante en ce qui concerne
les Balkans. La plupart des députés européens s'occupent de 3-5
dossiers très techniques en même temps. Quelques-uns s'intéressent
aux Balkans et c'est avec ceux-là que j'ai des réunions pour influencer
leurs rapports annuels.
Enfin, je peux aussi évoquer les ONG qui souvent s'inspirent de
mes analyses. Il faut distinguer les think tanks et les ONG faisant
des " campagnes " (tels que Amnesty International). Ces dernières
disposent en général de leurs propres sources d'information.
Avez-vous des concurrents,
i.e. des gens qui font le même genre de travail mais qui préconisent
d'autres politiques que vous ?
Il y a la European Stability Initiative, fondée par des anciens
collègues du ICG. Leur analyse est cependant beaucoup plus centrée
sur les problèmes économiques que la nôtre, qui est plus politique.
Le ICG ne fait pas d'analyse économique, notre mandat est différent.
On essaie d'avoir une certain complémentarité. Leurs méthodes sont
identiques aux nôtres, mais le ESI diffuse ses rapports plus que
nous. Certaines autres organisations ont des opinions radicalement
différentes des nôtres : ainsi le British Helsinki Human Rights
Group est très opposée à des interventions extérieures dans les
Balkans, ou encore le Comité International pour la Défense de Slobodan
Milosevic. Mais ces organisations ont beaucoup moins d'influence
que nous.
Qui prend l'initiative
pour un rapport de l'ICG ? En tant que facteur influent dans le
processus de formation des opinions à Bruxelles, est-ce que le ICG
fait des recommandations de politique de toute manière pour l'envoyer
aux responsables politiques, ou est-ce qu'il arrice que des acteurs
vous demandent conseil sur un problème spécifique ?
Il s'agit de notre propre initiative. Bien sûr nous sommes financés
par des gouvernements et des fondations (l'UE ne donne pas d'appui
financier), qui parfois suggèrent certains rapports à nos agents
sur le terrain. Mais c'est moi qui prend la décision. Par exemple,
il y a deux problèmes sur lesquels je préfère ne pas écrire : Je
ne veux rien publier sur le TPI de La Haye, car, comme un tel rapport
serait plutôt critique, il aurait un impact politique négatif en
renforçant des gens avec lesquels on n'est pas d'accord ! Un autre
sujet sur lequel je ne veux rien publier est le crime organisé.
Le ICG n'est pas la CIA, et nos propres agents sur le terrain ne
peuvent pas prendre de risques. Nous avons déjà eu des raisons pour
être inquiets de la sécurité de nos agents.
Le ICG dépend financièrement
de gouvernements, de fondations et d'entreprises. Est-ce que cela
met en cause son indépendance et influence des recommandations de
politique ?
Aucun donateur n'est en mesure de nous interdire d'écrire sur certains
choses. Je résisterais avec détermination une telle pression ! Il
se peut cependant qu'un membre du comité envoie certaines suggestions
sur ce qu'il faudrait mettre dans un rapport. Dans ce cas il se
peut que je prenne en considération certaines idées (mais pas forcément
toutes). Des contributions d'un insider concerné sont admissibles.
Comment est-ce que
le ICG attire l'attention sur ses analyses et tente de générer du
soutien pour ses recommandations de politique ?
Les rapports du ICG sont largement distribués par email et des copies
imprimés aux responsables des ministères des Affaires Etrangères
et aux organisations internationales. Ils sont aussi disponibles
sur le site internet, www.crisisweb.org. Je prends aussi directement
rendez-vous avec les responsables des gouvernements nationaux. Dans
ce cas je suis en général accompagné d'un de nos agents travaillant
sur le terrain. P.ex. on a organisé une telle mission l'année dernière
en Suisse.
Les dirigeants nationaux
et européens ont beaucoup de sources d'information. De la perspective
d'un preneur de décision, quel est l'avantage des recommandations
du ICG par rapport aux analyses faites par les représentants nationaux
dans les pays des Balkans ?
Des petits pays n'ont en général pas beaucoup de moyens d'observation
dans les Balkans. Les pays plus grands en disposent, mais leurs
gouvernements veulent vérifier leurs informations en les comparant
à d'autres analyses. Ils aiment les sources d'information alternatives.
De quels contacts
disposent vos analystes sur le terrain (société civile, contacts
dans le ministères etc.) ?
La société civile est bien sûr une cible majeure, mais j'évoquerais
aussi des institutions tels que le Ministère des minorités ethniques
en Serbie-Monténégro. Nous avons des relations étonnamment bonnes
avec eux, car à travers nos rapports ils espèrent attirer l'attention
internationale sur certaines affaires.
Est-ce que actuellement
le ICG tente d'amener l'UE à faire des changements dans sa politique
dans les Balkans ? Y a-t-il des dossiers sur lesquels les recommandations
de l'ICG sont en opposition complète avec la politique de l'UE telle
qu'elle est conduite aujourd'hui ?
Il y a certains points critiques que nous pouvons faire sur la politique
de l'UE. Tout d'abord, il n'y a pas assez de ressources. L'UE devrait
accorder davantage d'argent au soutien de l'ère post-Milosevic.
En général l'UE fait du bon boulot et publie des rapports sérieux,
mais il y a aujourd'hui plus de gens travaillant sur l'adhésion
de Malte que sur le dossier croate ! L'UE devrait aussi offrir davantage
d'étapes intermédiaires vers l'adhésion. Une autre critique concerne
le problème du statut final du Kosovo, que l'UE devrait résoudre
une fois pour toutes.
Est-il possible d'évaluer
l'impact réel d'une recommandation du ICG sur la politique effectivement
menée ? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets où un rapport
d'un ICG a eu un impact décisif sur la politique de l'UE dans les
Balkans ?
Nous avons fait une fois une évaluation d'impact : environ 40% de
nos recommandations sont effectivement réalisées. Ceci est la moyenne
pour chaque think tank. Chacun de nos quatre agents de terrain a
eu un succès. Par exemple en Macédoine nous avons réussi à mettre
le problème de la corruption à l'ordre du jour. En Serbie, nous
avons exposé les liens entre l'armée et le crime organisé, ce qui
a eu des conséquences en politique internationale et a reçu une
référence dans les conclusions du Conseil de l'Union. En Bosnie
nous avons eu un succès en ce qui concerne le problème du retour
des réfugiés avec notre recommandation de ne pas déclarer achevé
le retour des réfugiés. J'ai aussi eu une contribution personnelle
en Macédoine qui a influencé les accords de paix: les maires et
les chefs de police doivent se concerter, pour que la police ne
soit pas considérée comme un instrument de répression mais de community
builiding. Je peux aussi mentionner un rapport important sur le
nom officiel de la Macédoine [FYROM] qui a très influencé Skopje,
Athènes et d'autres capitales. Nous avons montré que la solution
de ce problème contribuerait la stabilité régionale.
Récemment Kofi Annan
a suggéré dans un discours que le " travail de médiation et de leadership
dans l'avertissement précoce et la prévention de conflit " du ICG
a été essentiel. Y a-t-il eu des cas où le ICG n'a non seulement
proposé des politiques, mais où l'un de vos collègues a été plus
directement impliqué comme intermédiaire et médiateur ?
Nous faisons parfois du travail de médiation, mais ceci n'est pas
vraiment notre mandat et nous essayons maintenant plutôt de l'éviter.
Il est cependant arrivé que des gens du terrain se sont adressés
à nous. Par exemple en Serbie du Sud, un responsable du gouvernement
nous a demandé notre aide pour attirer l'attention sur un certain
problème dans les institutions internationales. Mais la médiation
n'est pas le cœur de notre travail.
|
| Christoph
SIEGERS, euventures consulting, consultant |
|
Définition du métier
L'objectif d'euventures est d'assister
- d'une façon individuelle, innovatrice et consultative -
les institutions qui traitent les sujets formation, social, droits
de l'homme, humanitaire et culture au niveau européen. Euventures
consulting ne veut pas seulement être un cabinet de consulting
qui offre des services personnels et exclusifs, mais veut également
donner la possibilité aux institutions de réaliser
individuellement leurs intérêts à Bruxelles.
Euventures représente entre autres différentes institutions
éducatives allemandes d'utilité publique, le centre
de traitement pour les victimes de torture à Berlin, des
ONGs comme medica mondiale, CCME (Churches Commission for Migrants
in Europe) et la fondation Heinrich Böll. Son service est le
management de projets - consultation politique - information - représentation.
Parcours universitaire
C.S. a étudié le droit en Allemagne. Il trouvait les
études de droit horrible, mais à cause de son travail
à Amnesty International il pensait que le droit servirait
le mieux comme base pour un trouver un emploi plus tard. Les questions
concernant les droits de l'homme sont le plus souvent liées
à des questions juridiques.
Parcours professionnel
Pendant ses études, C.S. a déjà travaillé
comme porte-parole pour Amnesty International en Franconie / Bavière.
Ce qui était toujours évident pour lui, c'était
le désir de former quelque chose et de travailler dans le
secteur du social / des droits de l'homme.
Autrefois, il trouvait l'Europe ennuyeux et complètement
sans importance. Pour des motifs personnels, il est allé
en Belgique et plus tard à Bruxelles et il a fait l'entrée
classique à travers les institutions en faisant d'abord un
stage dans une représentation des communes allemandes (travail
très ennuyeux), et après au parlement européen.
Ensuite, il a eu la possibilité de travailler comme assistant
pour un député vert du parlement européen (membre
du comité intérieur). Cette activité a attiré
en outre son attention aux questions de l'asile et de la migration.
Dans le bureau du député arrivaient beaucoup de demandes
d'institutions concernant la remise de pétitions auprès
de l'UE et il se posait la question si le bureau pourrait apporter
ce service ou non.De cela, l'idée émergeait de fonder
une entreprise, qui met exactement ce service à la disposition.
Avec cet arrière-plan, C.S. a fondé euventures consulting
il y a 3 ans.
Professionnellement, il a depuis toujours refusé une réflexion
purement commerciale. Le travail avec et pour des ONGs est plus
varié et orienté vers d'autres objectifs. Jadis, il
a aussi écrit des pièces de théâtre et
il voulait simplement faire bouger quelque chose. Donc, les sujets
l'intéressent personnellement.
Les employés d'euventures ont des arrière-plans professionnels
tout à fait différents. Par exemple, Stephanie Diewitz,
responsable pour les secteurs du humanitaire et des droits de l'homme,
est d'origine journaliste.
Dans le cas de C.S., l'on pourrait donc dire, que il a créé
soi-même son métier présent.
Selon lui, les " métiers de l'Europe " sont plus
flexibles que ceux exercés au niveau national. A Bruxelles,
beaucoup est encore en mouvement, ils se produisent toujours de
constellations et des possibilités nouvelles. Beaucoup de
ses collègues, qui se sont établis à leur propre
compte, viennent de l'arrière-plan des institutions.
Perspectives de carrière à
moyen et long terme
C.S. désire que son entreprise croisse et qu'elle coopère
encore avec beaucoup d'institutions intéressantes. Il a également
quelques idées comme p.ex. l'intégration du secteur
de l'environnement.
Conseil à un étudiant
/ une étudiante
Selon, C.S. il ne faut pas seulement regarder les notes et les études,
mais il faut faire quelque chose d'exceptionnel.
De toute façon, les CVs se ressemblent souvent trop.
Quand il reçoit des demandes de stage ou d'emploi, il regarde
rarement les notes, ou alors tout à la fin. Des notes exceptionnelles
lui font plutôt peur.
Mais si quelqu'un - à la place de faire des vacances en Italie
- a préféré volontairement travailler dans
un projet d'environnement en Asie pour sauver des tortues, il a
plus de chance d'être embauché par euventures.
Il faut avoir de l'engagement social et ne pas penser seulement
à l'argent.
BALKANS
La particularité d'euventures
Actuellement, euventures dispose de bureaux dans les villes suivantes:
- Bruxelles, avec 4 employés et 1 à 2 stagiaires
- Cologne, qui se concentre sur la politique d'éducation
allemande, les organisations patronales et le social
- Berlin : une collaboratrice libre qui rédige les Newsletter
et qui s'occupe du site web
Par conséquent, les domaines
couverts par euventures sont actuellement : l'éducation,
le social, les droits de l'homme, l'humanitaire et la culture.
Au début, il y a 3 ans, euventures a travaillé pour
le Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin (BZFO) - centre
de traitement pour les victimes de torture - et des institutions
éducatives allemandes (bbw: Bildungswerk der bayerischen
Wirtschaft - institution éducative de l'économie bavaroise;
ESTA: Europäisches Bildungswerk - institution éducative
européenne; ...). Une étroite collaboration existe
également avec les églises, surtout avec le CCME (Churches'
Coalition for Migrants in Europe). Maintenant, il travaille aussi
pour la fondation Heinrich Böll et prochainement pour l'ENAR
(réseau européen contre le racisme et la xénophobie)
Euventures travaille comme un cabinet de consulting avec des contrats
de consultation, mais il se situe entre une entreprise et une ONG.
Il y a 10 ans, aucune ONG s'était laissée représenter
par une entreprise " commerciale " et chacun a fait son
truc. Cependant aujourd'hui, il existe une tendance de former des
réseaux et de chercher du soutien professionnel.
En ce qui concerne les Balkans, euventures travaille pour l'ONG
medica mondiale qui a des projets à Zenica (Bosnie), à
Gjakove (Kosovo) et à Tirana (Albanie).
Un autre projet concret était la formation d'un réseau
entre des organisations religieuses (Caritas, Diakonie) au sujet
du trafficking.
Description de la chaîne de transmission
Les tâches d'euventures sont : représentation - contact
- influence
Informer le public et faire connaître l'opinion publique aux
institutions.
Contrairement à presque tous les autres acteurs non-gouvernementaux,
qui dérivent en ce moment leur légitimation de leur
participation à la convention européenne, euventures
ne participe pas à ce domaine. Son travail concerne des projets
concrets, mais pas de lobbying général.
Un autre point important de leur travail est la formation de réseaux,
parce qu'il faut normalement avoir des partenaires transnationaux
pour une demande auprès de l'UE (surtout en ce qui concerne
le programme Phare et culture 2000).
Euventures a, par exemple, cherché des partenaires pour un
projet de la Caritas au sujet du " trafic de femmes ".
Pour les projets dans les Balkans, il faut normalement avoir plusieurs
organisations et partenaires. Il ne suffit pas toujours de se concentrer
sur des réseaux, parce que les demandes sont souvent trop
spécifiques pour qu'un réseau général
puisse suffire.
Acteurs principaux avec lesquels
il y a des interactions
Tout le spectre : Commission, Conseil, Parlement européen,
Représentation permanente de l'Allemagne, ministères
et l'administration à Berlin et à Bonn
Les contacts sont pris soit à la base de livres épais,
pleins de cartes de visite, soit à la base du " grand
livre bleu " qui contient toutes les adresses des institutions
européennes.
Normalement, les institutions sont contentes d'apprendre des informations
de la société civile, parce que elles sont parfois
trop éloignées et perdent leur lien direct avec elle.
Selon C.S., les contacts sont fortement concentrés / polarisés
sur le propre pays et la propre nationalité.
Sources d'information
Euventures écrit un propre Newsletter et des emails réguliers
à ces clients.
La majorité des des informations vient de l'internet, mais
les contacts personnels, les réseaux et une coopération
perpétuelle sont également importants.
Relation avec les autres acteurs
En général, il existe une ouverture du coté
des institutions européennes au travail d'euventures. La
Commission est même plus ouverte que le Conseil. Il est aussi
possible de parler directement aux députés du Parlement
européen
On peut atteindre beaucoup quand on choisit le bon moment. En plus,
il est important de savoir ce qu'on veut. Le lobbying est un art
particulier.
A Berlin, les institutions sont dans l'ensemble plus fermées
qu'ici.
Pour une organisation à Bruxelles, le plus important est
premièrement de se faire connaître et puis / ou en
même temps de déposer un bon projet.
Différences entre euventures et VOICE
Le réseau d'ONG " VOICE " représente ses
membres et n'est pas capable d'offrir un service individuel comme
euventures.
Euventures informe les organisations pour lesquelles on travaille
d'une façon spécifique et liée aux projets,
et s'occupe de la pétition jusqu'à la formulation
concrète. Ce travail ne peut pas être fait par des
grands réseaux, parce qu'il demande beaucoup de temps.
En ce qui concerne VOICE, elle jouit d'une position privilégiée
auprès d'ECHO.
Euventures - comme cabinet de consulting - connaît des désavantages.
En effet les ONG ont une meilleure réputation que les entreprises,
parce qu'elles peuvent prétendre de parler pour la société
civile.
Différence entre le travail d'euventures et le travail d'un
cabinet de consulting classique
La majorité des cabinets de consulting travaillent dans le
domaine de l'industrie. Là, il s'agit plutôt de questions
stratégiques et moins de projets concrets.
Avec d'autres jeunes conseillers actifs dans la politique allemande
et à Bruxelles, C.S. a fondé une " Gesellschaft
für Politikberatung - degepol" (www.degepol.de) - société
pour la consultation politique - , dans laquelle ils veulent développer
un Code of conduct. Au sein de cette société, il y
a également quelques cabinets de consulting industriel.
Euventures n'a pas de vrai concurrent, parce qu'il s'agit d'un petit
marché. Le consulting s'est surtout développé
en Angleterre, mais l'application de la méthode de consulting
dans le domaine social est quelque chose de nouveau, peut-être
même d'unique.
Cette orientation sociale pourrait être quelque chose typiquement
allemand.
|
|