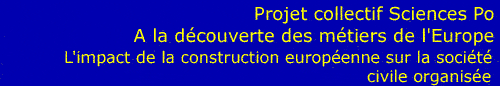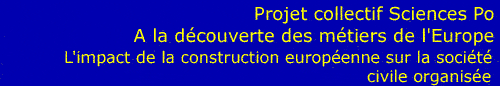|
L'enjeu du brevet communautaire
est double pour l'industrie pharmaceutique : d'un côté, il
s'agissait de veiller sur la refonte du brevet européen "
général " qui est applicable à tous les secteurs. Ce chapitre
est clôturé avec la décision lors du sommet d'Athènes en la
matière le 21 mars 2003. D'un autre côté, la Commission a
émis en 2001 une proposition pour renouveler la législation
dans le secteur pharmaceutique visant à changer profondément
la procédure d'autorisation de mise sur le marché des médicaments.
En octobre 2002, le Parlement Européen a amendé la proposition
initiale. En ce moment, on est dans l'attente de la nouvelle
proposition de la Commission tenant compte des amendements
faits par le Parlement.
I. Le brevet communautaire
Depuis une trentaine d'années, la législation européenne sur
les brevets était restée inchangée (ou inexistante). Jusqu'au
sommet d'Athènes le 21 mars 2003, il n'existait pas de brevet
communautaire à proprement parler. L'Office Européen des Brevets
de Munich octroyait ou non un " brevet européen " valable
dans tout le continent européen. Mais selon la législation
ancienne, la validité du brevet pouvait être mise en cause
non seulement au niveau de l'Office Européen des Brevets de
Munich (OEB), mais également par n'importe quel tribunal national.
Concrètement, un brevet accordé par l'OEB pouvait être accepté
par un juge français mais déclaré non valable par un juge
britannique. En fin de compte, il fallait déposer un brevet
dans chaque Etat membre pour éviter le risque de contradiction
des décisions de justice.
Les coûts engendrés et les hétérogénéités causées par cette
procédure constituaient un grave désavantage pour les entreprises
européennes par rapport à leurs concurrents étrangers (notamment
américains).
Cet enjeu est de taille également
pour l'industrie pharmaceutique européenne. Un rapport
sur la compétitivité du secteur pharmaceutique commandé par
la DG Entreprises de la Commission Européenne en 2000 concluait
que les entreprises européennes perdent de plus en plus de
terrain face à leurs concurrents américains. Ce rapport imputait
cette déficience en grande partie au manque de cohérence entre
les systèmes étatiques de santé (plus ou moins réglementés
suivant les Etats membres), mais également à une moindre efficacité
des processus d'innovation. En résumé : les entreprises américaines
se trouvaient sur un marché plus favorable et étaient plus
innovatrices ou efficaces en matière d'innovation.
D'où l'intérêt pour l'industrie pharmaceutique de voir arriver
un brevet communautaire qui protège à moindre coût leurs brevets.
Les représentants de l'industrie pharmaceutique au niveau
européen, l'EFPIA (European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations regroupant
les entreprises qui font de la recherche) et l'EGA (European
Generics Association) regroupant les entreprises produisant
des génériques), ont été consultés par la Commission lors
de l'élaboration de la proposition de brevet communautaire
(lien vers entretien Brunet). La
Commission a rendu les propositions accessibles sur le Web
pour recueillir les commentaires, notamment, en ce qui concerne
le secteur pharmaceutique, du comité permanent des médecins
de l'Union Européenne, des pharmaciens, d'organisations de
patients, d'organisations de recherche clinique.
Pendant le processus de négociation qui a suivi, l'EFPIA a agit en concertation
étroite avec l'UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations
of Europe) qui a représenté toutes les industries concernées
par le dossier des brevets et a agi principalement auprès
de la Commission et des Etats membres. L'approche de l'UNICE
repose surtout sur l'échange d' informations avec les fédérations
des différents secteurs industriels. L'interlocuteur principal
au sein de l'UE est la Commission, notamment le Conseil d'Administration
de la Commission du droit des brevets. Etant donné que la
procédure de co-décision n'est pas applicable en matière de
brevets, l'UNICE a - en concertation avec les industries concernées
- émis des propositions auprès de la Commission (lien vers
entretien Konteas).
Les différents acteurs savent que l'instance décisive est
le Conseil des ministres. Pour s'assurer que leurs propositions
sont également prises en compte à ce niveau-là, les acteurs
européens se sont servis des réseaux nationaux. L'EFPIA est constituée de fédérations
nationales et d'entreprises de taille importante qui disposent
de contacts avec les pouvoirs politiques et les administrations
nationales (lien vers entretien Campolini)
- il en va de même pour l'UNICE qui regroupe les organisations
patronales de chaque Etat membre.
Pour les groupes n'ayant pas d'accès privilégié à ces réseaux,
il y a également la possibilité de recourir aux services d'un
cabinet de consulting, soit pour essayer d'influencer le processus
de décision, soit pour être tenu au courant des progrès en
la matière. Dans cette optique, les lobbyistes professionnels
soulignent l'ouverture des institutions européennes : en général,
il est relativement facile de faire entendre les avis des
acteurs concernés (lien vers entretien Vanovertveld)
Finalement, le Conseil des ministres a adopté lors de son
sommet d'Athènes un compromis proposé par la présidence grecque
: en 2010 une cour européenne des brevets sera mise en place
à Luxembourg, qui tranchera désormais toutes les litiges en
la matière. Jusqu'à cette date, les tribunaux nationaux restent
compétents. De plus, les brevets peuvent désormais être rédigés
en une seule langue (Français, Anglais ou Allemand) à l'exception
des trois premières pages, qui doivent être traduites dans
toutes les langues officielles de l'UE.
2. La réforme de la législation pharmaceutique
A l'enjeu de l'unification du brevet
s'ajoute un deuxième dossier d'importance. Le 18 juillet 2001,
la Commission a proposé une réforme complète de la législation
pharmaceutique de l'UE. Cette initiative était prévue lors
de la création de l'Agence Européenne de l'Evaluation des
Médicaments (EMEA) en 1993 (règlement
2309/936; Directive 93/41/CEE). Dès les années 60 après le
" désastre de la thalidomide ", et sous l'impulsion des organisations
de patients et de consommateurs comme le BEUC (Bureau Européen
des Unions de Consommateurs) (lien vers entretien Craenen) les médicaments
sont soumis à un examen rigoureux. Pour être mis sur le marché,
un médicament a besoin d'une autorisation délivrée suite à
une étude approfondie des effets du médicament.
Avec la création de l'EMEA, l'industrie dispose
de deux procédures d'autorisation possibles. D'un côté la
procédure centrale (faite par l'EMEA, valide pour tous les
pays) et la " procédure de reconnaissance mutuelle " (l'instance
nationale autorise le médicament, les autres pays reprennent
cette autorisation sur demande). Cette dernière est favorisée
par les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas présentes
sur la totalité du marché européen. Mais cette démarche a
le désavantage d'être lente. De plus l'autorisation d'un pays
n'est pas toujours reprise : il existe entre les Etats membres
de fortes différences dans la perception de certaines maladies
et de leur traitement. Par contre, la procédure centrale est
considérée comme un succès, mais risque de devenir également
trop lente avec l'élargissement de l'UE (et l'élargissement
proportionnel de ses organes de décision). Dans le souci de
soutenir la compétitivité du secteur il se pose aussi la question
de la durée de la protection des informations sur les médicaments
(et en corollaire à partir de quand des génériques de ces
médicaments peuvent être produits).
A cet enjeu économique s'ajoute la volonté d'améliorer " la
protection générale de la santé des citoyens européens " (Erkki
Liikkanen, 18.7.2001). Plus précisément, la Commission a proposé
que les patients aient accès à une base de données comprenant
des informations sur tous les effets secondaires des médicaments.
De plus, les patients souffrants de maladies comme le VIH,
le diabète et l'asthme peuvent être directement informés par
l'industrie pendant une période de test de 5 ans.
L'envergure du propos de la Commission a suscité un lobbying
intense des différents groupes jusqu'à ce jour. L'industrie
s'est surtout exprimée par la voie de ses organisations européennes
(d'après les parties prenantes il n'y a pas d'entreprise qui
ait agi seule). De façon générale, on peut discerner deux
camps : l'EFPIA et l'EGA. Le premier regroupe les entreprises
qui investissent dans la recherche (comme par exemple la Bayer
Healthcare (lien vers entretien Stöckert)) et qui
essayent d'obtenir une période de protection la plus longue
possible. Pour ce faire, l'organisation a créé une " Priority
Action Team " composée de 25 experts issus des différentes
entreprises dont une moitié de pharmacologues. Ce comité poursuit
deux stratégies : d'un côté il s'adresse à la Commission lors
des consultations, essentiellement sous forme écrite. En parallèle,
il mène des discussions " de fond " avec les instances d'autorisation
nationales et l'EMEA. L'idée est que les
ministres prenant part au Conseil sur la santé, Conseil qui
va finalement décider sur le sujet, fonderont leur décision
sur l'avis de " leurs " instances nationales. De plus, les
fédérations nationales faisant partie de l'EFPIA font du lobbying auprès
des parlementaires européens. Pour l'EGA la démarche est largement
identique, avec bien sûr des objectifs différents, visant
à une durée de protection des informations sur les médicaments
moins longue.
Avec la publication de la proposition par la Commission, la
réforme est entrée dans le processus de décision. Vu l'ampleur
des changements envisagés, le comité de la santé du parlement
européen a désigné deux rapporteurs pour le dossier, puisqu'il
fallait modifier deux règlements et une directive. Même si
chaque grande groupe politique (PSE et PPE) a pu nommer un
rapporteur (Mme Grossetête et Mme Müller), il y avait en plus
un certain nombre de rapporteurs fictifs des autres groupes,
qui travaillaient également sur le sujet. L'élaboration de
la proposition qui a été votée début octobre 2002 au Parlement
a pris un an. Pendant ce temps, les deux rapporteurs, s'appuyant
sur les recherches faites par leurs assistants (lien vers entretien Klein) ont essayé de
prendre en compte les avis des différents acteurs. Un travail
qui est souvent rendu plus difficile par des obstacles linguistiques,
ce qui mène à une certaine prépondérance des organisations
ayant la même " nationalité " que le rapporteur. Quand même,
tous les acteurs ont pu s'adresser au Parlement : soit par
des interventions écrites au rapporteur, aux membres du comité
de la santé, voire à tous les députés, soit par le biais de
cabinets de conseils ou de conférences spécifiques.
|